| Ce billet est un extrait adapté de ma thèse de doctorat (Dor 2015) et reprend des éléments d’un article publié dans Game Studies (Dor 2018). |
On dit souvent que, dans un travail universitaire, on doit s’assurer de définir nos termes. Définir les mots qu’on utilise ne veut pas dire qu’on peut toujours inventer une définition en ne se basant sur rien. Tout dépend, dans les faits, du type de définition qu’on souhaite. Umberto Eco, dans Le signe, distingue deux manières de définir un terme : une définition dictionnairique et une définition encyclopédique (1988, p. 144-154). La première consiste en l’établissement d’un terme d’une manière linguistique, alors que la seconde cherche à y intégrer « notre connaissance du monde » (p. 144).
Dans le premier type de définition, « les propriétés d’un terme qu’on y trouve lui appartiennent en vertu de sa propre définition, et ces propriétés ne sont ni vérifiées ni falsifiées par une vérité factuelle » (p. 146). Si je définis les jeux de stratégie en temps réel (STR) comme tout jeu qui implique de la stratégie et du temps réel, j’inclus par définition tous ces jeux dans les STR; si quelqu’un avance qu’un spécimen de STR n’a pas ces deux éléments, on lui rétorquera alors simplement qu’il ne s’agit pas par définition d’un STR. Pour qu’elle fonctionne dans un contexte linguistique, il faudrait qu’une définition dictionnairique repose sur des « universaux sémantiques » (p. 146), soit des termes premiers qui n’auraient pas à être eux-mêmes définis parce qu’ils seraient « intuitivement connus de tous les locuteurs ». Dans notre cas, il faudrait par exemple que « stratégie » et « temps réel » soient clairement établis sans nécessiter eux-mêmes une définition.
L’apparente rigueur du « modèle dictionnaire »
C’est essentiellement des définitions dictionnairiques que le pragmatiste Charles S. Peirce souhaite voir adopter en philosophie, en abandonnant l’habitude de l’usage quotidien pour avoir la précision et la rigueur lexicale des disciplines des sciences naturelles ([1904] 1991, p. 246). On définirait alors un mot d’une manière conventionnelle pour clarifier un concept, une idée, cette définition n’étant pas elle-même l’objet de la discussion. Par contre, dans une discipline qui, elle-même, s’intéresse aux discours, il reste difficile de prendre une terminologie qui va à l’encontre de l’imprécision des usages courants.
La polysémie des mots
En s’inscrivant dans une perspective historienne, deux problèmes émergent. Paul Ricœur en expose un dans Histoire et vérité : le travail d’analyse des sources révèle la complexité d’un certain nombre de termes — pensons, par exemple, à ce qu’implique la définition des termes comme « tyrannie, servage, féodalité, État » ([1955] 1967, p. 35). Suivant la particularité du contexte sociohistorique, ces termes en viennent à prendre des sens variés. Ricœur note bien que « jamais l’historien ne se trouve dans la situation du mathématicien qui dénomme, et, en dénommant, détermine, le contour même de la notion » ([1955] 1967, p. 35). Le langage de l’historien est, pour lui, « nécessairement équivoque », en grande partie parce que l’historien écrit et décrit pour pallier à la distance historique de ses lecteurs.
L’utilité théorique des concepts
Le second problème qui me semble émerger, souligné cette fois-ci par Paul Veyne, c’est que l’utilité théorique d’une définition est incertaine. L’exemple de Veyne est le type du « despotisme éclairé ». On peut entendre un type comme un modèle ou un concept; bref, comme une définition dictionnairique. Veyne écrira que « l’invocation au type n’ajoute rien à l’explication » ([1971] 1996, p. 167); essentiellement, comprendre qu’une certaine monarchie correspond à un type comme le despotisme éclairé ne révèle rien sur ce même despotisme, parce qu’on doit d’abord et avant tout comprendre le régime pour voir jusqu’à quel point et sous quels aspects il peut être considéré comme un despotisme éclairé. Recourir à un type revient alors à « abréger une description » (p. 167). Une définition dictionnairique ne peut que difficilement faire autorité dans une démarche historienne. Les discussions sur les définitions dictionnairiques portent règle générale sur l’utilité théorique ou descriptive du concept même.
La réfutabilité du « modèle encyclopédique »
La définition encyclopédique, quant à elle, consiste à comprendre l’histoire et la généalogie du terme, à y intégrer, comme je l’ai noté, « notre connaissance du monde » (Eco 1988, p. 144). Ce type de définition est plus difficile à cerner dans la mesure où cette « connaissance du monde » est toujours sujette à discussion. Elle a, contrairement à son homologue dictionnairique, une prétention à la vérité par réfutabilité parce qu’elle s’applique à un contexte dans lequel elle prend sens. Suivant la compréhension de ce contexte, une définition pourra être désignée comme vraie ou fausse. L’encyclopédique donne ainsi « un ensemble d’instructions concernant la manière de comprendre un terme donné dans les contextes où, statistiquement, il apparaît le plus fréquemment » (p. 149). Ainsi, la série Total War (2000-) s’inscrit parfois dans les STR suivant une définition encyclopédique du terme alors qu’en mode solo, la composante « en temps réel » du jeu est fragmentaire et optionnelle. Écrire une définition encyclopédique d’un terme implique en ce sens d’entreprendre une démarche de recherche sur son utilisation réelle et avérée — pragmatique au sens de la linguistique — plutôt qu’une démarche logique de son utilisation souhaitée.
L’« ontologie » du jeu en études du jeu vidéo
Tous les débats sur l’« ontologie » du jeu en études du jeu vidéo et en études des médias d’une manière plus générale concernent l’établissement d’une définition dictionnairique : voici ce qu’une chose ou un média est constitutivement, sans qu’on s’intéresse à son usage ou à la généalogie de son apparition. Si dans certains cas on parle d’ontologie au sens philosophique du terme, Espen Aarseth note que c’est souvent la définition des sciences informatiques qui sera reprise, soit « a formal mapping of an empirical domain » (2014, p. 484).
Ces débats sont une manière pour un chercheur de circonscrire ce qu’il veut expliquer ou définir en cherchant à faire autorité en la matière pour un certain nombre de travaux futurs, voire pour le champ d’études en entier. Aarseth (2003) propose de définir l’objet d’études des game studies en parlant davantage de « games in virtual environment » plutôt que de « video games » ou « computer games », de sorte d’inclure les jeux de société proposant un univers diégétique, mais d’exclure les jeux comme le poker ou le blackjack.
Ce travail vise vraisemblablement à proposer des outils théoriques qui s’appliquent au champ d’études en entier; mais tout cadre créé comme un a priori à la discipline en limite nécessairement la portée et exclut le contexte culturel dans lequel le sens de ces mots émerge. Eric Zimmerman ([2004] 2010), en voulant définir les « four naughty concepts in need of discipline » que sont narrative, interactivity, play et game, ne cherche pas à synthétiser un usage existant de ces termes, mais plutôt à en circonscrire des limites pour un usage ultérieur disciplinaire. Une fois son travail descriptif terminé, Zimmerman affirme presque paradoxalement qu’il est « difficult to understand exactly and precisely what a game is ». Cette difficulté s’explique bien sûr en partie par une certaine fidélité aux usages préexistants, mais aussi et surtout par la complexité d’une définition claire du phénomène.
L’ontologie des jeux vidéo partage avec l’analyse philosophique le développement de relations conceptuelles plutôt que l’explication de relations déjà existantes. La Stanford Encyclopedia of Philosophy explique bien que l’établissement d’une définition en recherche philosophique « do not aim at stating explanatory relations, but rather at identifying and developing conceptual ones », de la même manière qu’une définition du dictionnaire (Brennan [2003] 2012). On n’y décrit pas pourquoi les choses sont comme elles sont ni les raisons qui nous poussent à penser qu’une chose est telle qu’elle est; c’est la cohérence et la clarté conceptuelle qui importent. Ce n’est pas très différent chez Zimmerman et Aarseth : ce sont la cohérence et l’utilité théorique de la définition des termes qui sont mises en cause, pas la synthèse de leurs usages préexistants. Une définition dictionnairique ne cherche pas nécessairement à faire autorité pour des usages futurs; un philosophe peut, par exemple, définir un mot pour mieux clarifier sa propre philosophie sans affirmer que ce mot devrait prendre le sens qu’il lui donne dans les travaux d’autres penseurs.
Wittgenstein et l’encyclopédie
La définition encyclopédique d’un terme rejoint l’idée de Ludwig Wittgenstein reprise de nombreuses fois dans l’étude du jeu vidéo et sur laquelle Jesper Juul revenait sur son blogue (2013). Dans ses Recherches philosophiques, Wittgenstein ([1953] 2004, p. 63-64, §66-67) suggère que lorsqu’on emploie un terme comme celui de « jeu » dans la vie quotidienne, on n’implique pas que tout ce qui est recoupé par le terme corresponde à un certain nombre de critères qui seraient valables pour tous ses usages. Autrement dit, si j’utilise le mot « jeu » pour parler de Super Mario Bros. (Nintendo, 1985), je n’ai pas en tête une définition du mot qui puisse correspondre à toutes les fois où j’ai utilisé le mot « jeu ». Plutôt que des critères fixes et précis, l’ensemble de ce que je regroupe sous le mot « jeu » possède des « ressemblances de famille ».
En reprenant la lecture qu’en a fait Bernard Suits dans The Grasshopper, soit que « games are indefinable », Juul suggère que, pour Wittgenstein, les mots n’ont pas de significations définies et précises. En fait, c’est essentiellement une distinction semblable à celle qu’Eco fera plusieurs années plus tard que Wittgenstein propose dans ses Recherches. À titre de clarification, sur le concept de « nombre », il écrit :
Je peux en effet donner ainsi au concept de « nombre » des limites strictes, c’est-à-dire employer le mot « nombre » pour désigner un concept strictement délimité, mais je peux également employer ce mot de façon à ce que l’extension du concept ne soit pas circonscrite par une limite. Et c’est bel et bien ainsi que nous employons le mot « jeu » ([1953] 2004, p. 65, §68, tel quel).
Wittgenstein n’exclut pas l’idée qu’on puisse définir un terme d’une manière très précise (une définition sous le « modèle dictionnaire »); il décrit plutôt la manière dont le mot « jeu » est effectivement employé dans la vie quotidienne (une définition encyclopédique). Personne ne voit un problème à ce que je parle de « jeu » pour parler alternativement de jeux de cartes, de jeux vidéo, de sport, de quiz télévisés, de télé-réalité ou de jeu de séduction. Rien n’exclut une définition plus précise pour quelqu’un qui cherche à définir une discipline universitaire. Les définitions dictionnairiques et les définitions encyclopédiques servent des intérêts différents ; il importe de ne pas les confondre lorsqu’on veut circonscrire un corpus, en particulier dans le contexte d’un objet culturel ayant une histoire dont on cherche à tenir compte.
Références
Aarseth, Espen. 2003. « Playing research: methodological approaches to game analysis ». Dans 5th International Digital Arts & Culture Conference, édité par Adrian Miles. Melbourne, Australia: RMIT University, School of Applied Communication.
Brennan, Andrew. 2012. « Necessary and sufficient conditions ». Édité par Edward N. Zalta. The Stanford encyclopedia of philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. http://plato.stanford.edu/entries/necessary-sufficient/.
Dor, Simon. 2015. « Repenser l’histoire de la jouabilité : l’émergence du jeu de stratégie en temps réel ». PhD Thesis, Montréal: Université de Montréal.
———. 2018. « Strategy in Games or Strategy Games: Dictionary and Encyclopaedic Definitions for Game Studies ». Game Studies, vol. 18, no. 1. http://gamestudies.org/1801/articles/simon_dor.
Eco, Umberto. 1988. Le signe : histoire et analyse d’un concept. Bruxelles: Labor.
Juul, Jesper. 2013. « Ring a ring o’ roses as a game ». The Ludologist (blogue). http://www.jesperjuul.net/ludologist/ring-a-ring-o-roses-as-a-game
Peirce, Charles S. [1904] 1991. « [“Pragmatism” defined] ». Dans Peirce on signs: writings on semiotic, p. 246-248. Chapel Hill : University of North Carolina Press.
Ricœur, Paul. [1955] 1967. Histoire et vérité. Points, Essais. Paris: Seuil.
Veyne, Paul. [1979] 1996. Comment on écrit l’histoire : texte intégral. Paris: Seuil.
Wittgenstein, Ludwig. 2004. Recherches philosophiques. Paris: Gallimard.
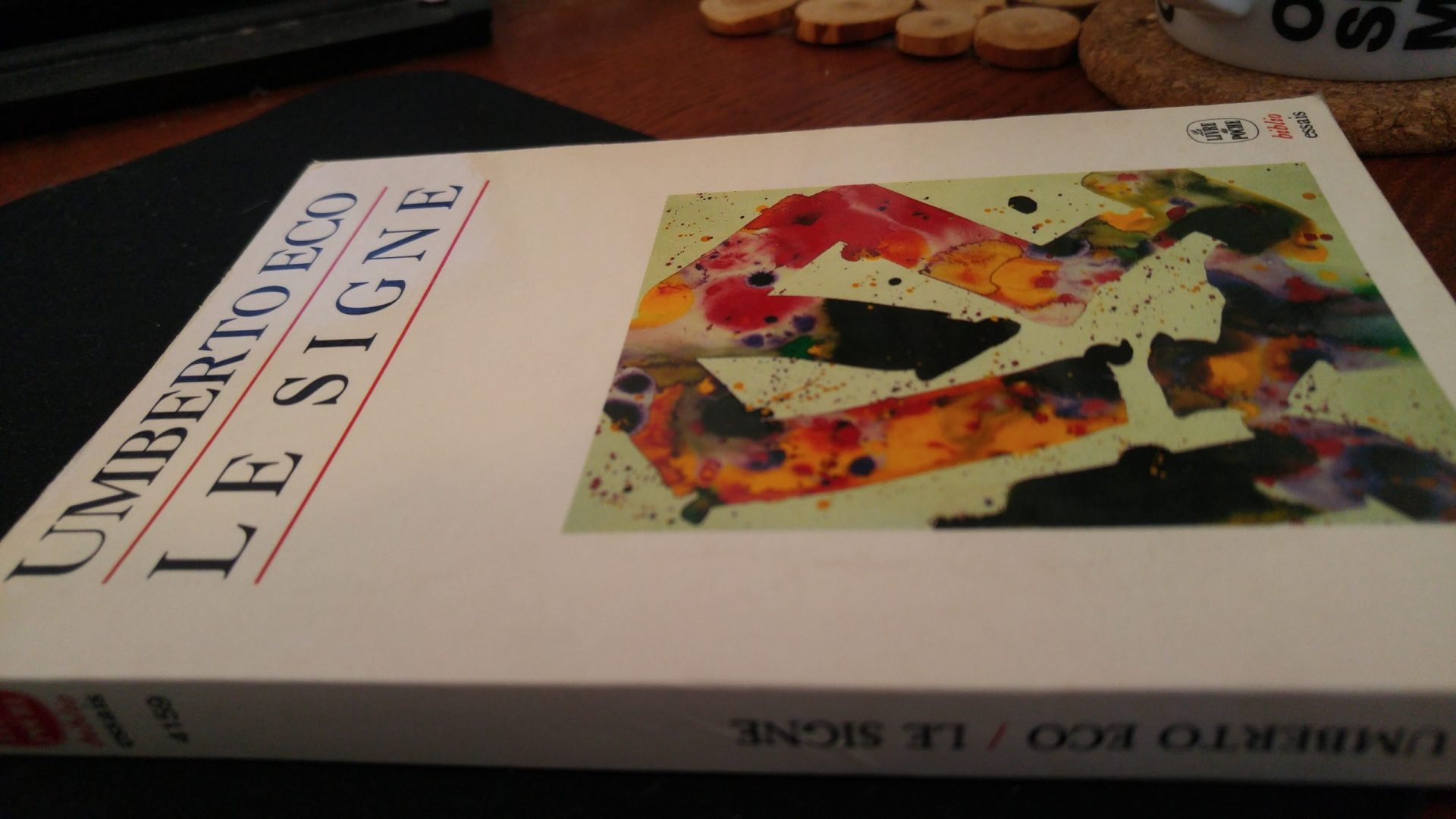
Laisser un commentaire